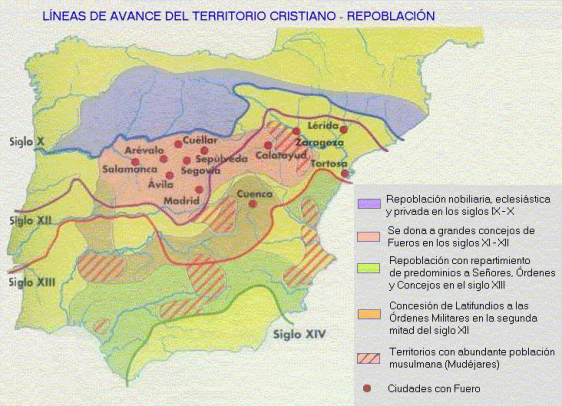L’invasion arabe de 711 change le cours de l’histoire d’Espagne. Depuis cette date, la péninsule Ibérique est partagée entre deux civilisations : l’Orient musulman et l’Occident chrétien. D’un côté, ce que les textes arabes appellent al-Andalus, l’islam d’Espagne ; de l’autre, l’Hispania chrétienne. L’Espagne musulmane est alors intégrée dans un bloc relativement homogène qui va de l’Indus à l’océan Atlantique ; malgré les fractionnements régionaux, on trouve partout la même religion, la même langue, la même loi.
Al–Andalus désigne l’ensemble des territoires ibériques soumis à la domination musulmane. La définition géographique de cet espace a beaucoup varié au cours des siècles. Correspondant à la majeure partie de la péninsule au lendemain de la conquête, il se réduit régulièrement au point de se limiter, à partir de la seconde moitié du XIIIe siècle, au seul royaume nasride de Grenade
L’Espagne tombe bientôt sous la domination arabe. Tariq ibn Ziyad, chef berbère devenu lieutenant de Moussa ibn Nossayr, franchit le détroit de Gibraltar en 711, bat le roi wisigoth Rodrigue et occupe Cordoue et Tolède. Vers 714, Moussa ibn Nossayr le rejoint en Espagne et prend Saragosse. Les deux chefs occupent la majeure partie de la péninsule Ibérique, la conquête s’est réalisée avec une rapidité foudroyante. En 716, une nouvelle province musulmane dépendante du Califat de Damas est constituée. Une grande proportion de chrétiens convertis à l’islam ainsi que des musulmans de diverses nationalités – Arabes, Syriens et Berbères – fondèrent en Espagne de petites colonies. Les riches terres de l’Espagne méridionale, à laquelle ils donnèrent le nom al-Andalus, présentaient un intérêt incontestable comparativement aux déserts de l’Afrique du Nord.
Abd ar-Rahman I, dernier héritier des califes omeyyades, réussit à échapper au massacre de sa famille, quitta la Syrie et passa en Espagne, où il prit Séville puis Cordoue (756) et fonda un émirat indépendent. Abd ar-Rahman III mit un terme à une période de troubles, unifia l’Espagne mauresque et se proclama Calife (929). Son règne (912-961), époque de prospérité économique et de splendeur culturelle, marque l’apogée de l’Espagne musulmane.
Cette situation dura sous le gouvernement du lettré ambitieux Ibn Abi Amir, connu sous le nom d’al-Mansour («le Victorieux», Almanzor pour ses adversaires castillans) qui se substitue progressivement au souverain légitime (le calife) jusqu’à sa mort en 1002. Au XIe siècle, le califat de Cordoue se morcelle en petits royaumes : l’époque des Taïfas (1031-1094) est troublée par des guerres. Cette division facilite la reconquête chrétienne venue du nord. Les rois chrétiens enhardis obtiennent que certaines Taïfas leur livrent un tribut après avoir connu la défaite.
La prise de Tolède (1085) alarme les Musulmans en Espagne et aussi à l’Orient [c’est l’époque de la première Croisade] et les rois des Taïfas font appel aux dynasties berbères des Almoravides (1086-1147) et des Almohades (1147-1212), qui représentent un Islam plus rigoureux. Ils vont porter la guerre sainte en Espagne pour prêter main-forte à l’Islam andalou menacé de disparition. Après 1212 (bataille de Las Navas de Tolosa), seul le sud de la péninsule est toujours sous contrôle musulman. En 1248, les chrétiens reprennent Séville. Seul le petit émirat de Grenade résiste jusqu’en 1492. À cette date, l’Espagne sur le plan politique est redevenue totalement chrétienne.
Al-Andalus était, à bien des égards, radicalement différente de l’Europe chrétienne. Alors que l’Europe rurale s’était appauvrie, al-Andalus était une région de villes prospères tournées vers le commerce. Ses produits, notamment le verre, le papier, le cuir, l’orfèvrerie et les soieries, jouissaient d’une grande renommée jusqu’en Inde. Les souverains musulmans toléraient généralement les chrétiens et les juifs et encourageaient la diversité culturelle.
Les apports des musulmans ont enrichi la culture espagnole. La civilisation hispano-musulmane a participé à l’âge d’or de l’Islam. Les sciences, la médecine et la philosophie étaient florissantes, en particulier à Cordoue, la capitale. Les savants islamiques espagnols, tel Averroès, étudièrent les œuvres d’Aristote et des autres philosophes grecs, qui furent traduites en latin avant d’être diffusées dans le reste de l’Europe. Les califes construisent des bibliothèques et favorisent l’épanouissement de la culture : le futur Pape Sylvestre II vient étudier la science des sages arabes compulsée à Barcelone. Un certain nombre de mots de la langue espagnole viennent de l’arabe. De nouvelles cultures et techniques agricoles, venues d’Afrique ou d’Orient, sont introduites. Les grandes villes d’al-Andalus sont des centres d’un artisanat raffiné (travail du cuir à Cordoue). Elles sont également des marchés importants et des foyers d’études.